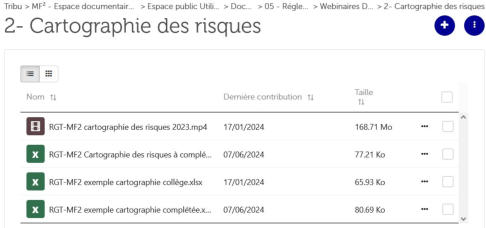08/25
Gestionnaire03


© Site «Gestionnaire03» / Bernard Blanc / 2023 / 2024 / 2025 / 2026

Organisation du poste comptable
I - L’
organisation
du poste comptable.
Une
étude
faite par l’académie d’Aix-Marseille (mai 2011 - à adapter, notamment avec les changements induits par Op@le) :
La
taille
des
groupements
comptables
influence
l’organisation
du
poste
comptable.
Dans
un
groupement
comptable
de
petite
taille,
l’agent
comptable
reste
avant
tout
un
gestionnaire-comptable
;
la
spécificité
du
métier
de
gestionnaire
l’emporte
sur
celle
d’agent
comptable,
ce
qui
est
dénoncé
par
la
Cour
des
Comptes
dans
ses
différents
rapports
comme
contraire
au
principe
de
la
séparation
ordonnateur-comptable.
Dans
un
groupement
comptable
de
taille
plus
importante,
un
tel
rôle
joué
par
le
comptable
n’est
plus
possible
:
le
volume
de
travail
comptable
traité
augmente,
le
risque
de
débet
qui
en
résulte
s’accroît
;
l’agent
comptable
doit
devenir
un
véritable
comptable.
La
professionnalisation
des
différents
acteurs
du
poste
comptable
s’ensuit,
l’organisation
du
poste
comptable
également.
Le
service
«
Gestion
»
doit
être
distinct
du
service
«
Comptabilité
».
Les
tâches
confiées
aux
collaborateurs
des
deux
services
doivent
bien
être
séparées
(si
possible
dans
l’espace
et/ou
dans
le
temps) et retranscrites de façon précise dans un organigramme.
II -
Convention
de groupement comptable.
En
provenance
de
l’académie
de
Rennes,
un
modèle
de
convention
pour
un
groupement
comptable
;
mais
un
document
ancien
puisque
de
2005.
D’autres
exemples
de conventions sont disponibles dans la page imprimés concernée. A adapter, notamment avec les changements induits par Op@le.
Toujours sur le groupement ou regroupement comptable, un autre
document
récapitulatif très complet de l’académie de Reims de mai 2008.
Un
exemple
de convention (2012).
Un
modèle
plus récent (2017) de l’académie d’Aix-Marseille.
III -
Diagnostic
du poste comptable - Contrôle interne comptable.
La page dédiée du site du rectorat de Marseille :
m@gistère
; incontournable. A adapter, notamment avec les changements induits par Op@le.
Carnet n°47
(2013) : «Le contrôle interne comptable et financier. La maîtrise des risques comptables et financiers».
Circulaire n° 2013-189
du 14-10-2013 portant sur la carte comptable et la qualité comptable en EPLE.
III.1 - Définition.
Le
contrôle
interne
se
définit
comme
«
l’ensemble
des
dispositifs
formalisés
et
permanents
choisis
par
le
chef
d’établissement
et
l’agent
comptable
et
mis
en
œuvre
par
les
responsables
de
tous
niveaux
pour
maîtriser
le
fonctionnement
de
leurs
activités
financières
et
patrimoniales
:
ces
dispositifs
sont
destinés
à
fournir
une
assuranceraisonnable quant à la réalisation de l’objectif de qualité comptable
».
L’absence
ou
l’insuffisance
de
contrôle
interne
est
fréquemment
dénoncée
dans
les
rapports
d’audit
effectués
par
les
inspecteurs
vérificateurs
des
Finances
Publiques.
En
effet,
au
niveau
de
chaque
établissement
et
de
chaque
agence
comptable
doit
être
mis
en
place
un
contrôle
de
ce
type.
Le
contrôle
interne
fait
partie
du
pilotage
de
l’établissement
;
c’est
avant
tout
une
démarche
de
pilotage
inhérente
à
l’activité
de
tout
encadrement
qui
est
suivie
à
son
niveau
par
tout
agent
et
qui
est
indissociable
de
ses
tâches
de
gestion
;
elle
est
destinée
à
l’aider
au
quotidien
à
maîtriser
son
activité.
Les
objectifs
de
ce
contrôle
interne
sont
de
prévenir,
d’encadrer
et
de
gérer
les
risques
afin
d’assurer
la
protection
du
patrimoine
de
l’établissement,
la
régularité
des
opérations
de
la
comptabilité,
l’optimisation
des
besoins.
Il
repose
sur
une
analyse
des
différentes
tâches
exercées
dans
une
chaîne
d’opérations,
qui
fait
quoi,
et
sur
une
analyse
des
risques,
quel
risque
encourt-on
pour
telle
opération,
qui
doivent être identifiés et hiérarchisés. En cas de dysfonctionnement, des mesures correctives sont mises en oeuvre pour y remédier.
La
parution
du
décret
n°2011-775
du
28
juin
2011
confère
dorénavant
le
caractère
d'obligation
réglementaire
à
la
mise
en
oeuvre
du
contrôle
interne
dans
les
administrations
publiques.
Cette
dernière
notion
est
plus
large
que
celle
de
contrôle
interne
comptable,
car
elle
dépasse
le
champ
des
domaines
budgétaire,
comptable
et
financier.
La
relance
du
contrôle
interne
comptable
au
sein
des
ministères
chargés
de
l'éducation
nationale
et
de
l'enseignement
supérieur
de
2011
est
donc
une
composante
de
cette
politique
globale.
Elle
s'effectue
à
travers
un
plan
d'action
ministériel
(PAM)
dont
certaines
actions
nécessitent
le
concours
des
services
académiques et/ou des EPLE. Vous trouverez le dossier de référence sur ce sujet sur l'intranet de la DAF : rubrique contrôle interne comptable.
La
mise
à
votre
disposition
de
l'outil
de
diagnostic
ODICé
a
permis
d'initier
dès
2007
la
démarche
du
contrôle
interne
comptable
dans
les
EPLE.
Cet
outil
a
toutefois
été
mis en oeuvre de façon très hétérogène, et, comme beaucoup d'autres, il doit être adapté aux dispositions de l'instruction codificatrice M9.6.
III.2 - La qualité comptable.
La qualité comptable permet de donner une image fidèle de la situation financière et patrimoniale et porte sur :
• la régularité des comptes, c'est-à-dire leur conformité aux règles et procédures en vigueur ;
•
la
sincérité
des
comptes,
c'est-à-dire
l'application
de
bonne
foi
des
règles
et
procédures
en
vigueur,
afin
de
traduire
la
connaissance
que
les
responsables
de
l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des évènements enregistrés ;
• l'exhaustivité des comptes (les droits et obligations des entités sont enregistrés en totalité, sans contraction entre eux) ;
• l'imputation comptable ;
• le rattachement à la bonne période comptable et au bon exercice.
III.3 - La sécurisation des procédures financières et comptables.
La sécurisation des procédures financières et comptables est facilitée par la mise en oeuvre du CICF qui repose sur quelques préceptes :
• formalisation d'organigrammes fonctionnels, de fiches de postes et des délégations de signature ;
• réalisation de fiches de procédure ;
• identification des risques par les audits, les contrôles externes, les contrôles des agents et de l'encadrement ;
•
diminution
des
risques
par
les
formations,
les
instructions
et
autres
directives,
les
modifications
des
procédures,
la
révision
de
l'organisation
et
la
formalisation
des
contrôles de supervision ;
• justification du contrôle interne par la mise en place de la traçabilité de toute la chaîne CICF depuis l'organigramme fonctionnel jusqu'aux contrôles.
(cf. paragraphe 2133 de l'IC M9.6)
III.4 -
MRCF
-
ODICE
.
Article 215 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
•
Le
contrôle
interne
budgétaire
a
pour
objet
de
maîtriser
les
risques
afférents
à
la
poursuite
des
objectifs
de
qualité
de
la
comptabilité
budgétaire
et
de
soutenabilité
de la programmation et de son exécution.
•
Le
contrôle
interne
comptable
a
pour
objet
la
maîtrise
des
risques
afférents
à
la
poursuite
des
objectifs
de
qualité
des
comptes,
depuis
le
fait
générateur
d’une
opération jusqu’à son dénouement comptable.
MRCF = CIB+CIC+Audit interne+plan d'action.
La cartographie des risques pour utilisateurs d’Opale.
Sur
le
site
Tribu,
rubrique
MF2
-
Espace
documentaire
Op@le,
retrouvez
le
webinaire
de
la
DAF
de
janvier
2024
avec
les
fichiers
pour
réaliser
votre
propre
cartographie des risques de votre établissement.
L’ancien ODICE pour GFC (2018).
La
note
DAF
du
18
octobre
2017
sur
la
Maîtrise
des
Risques
Comptables
et
Financiers
(MRCF)
et
le
déploiement
de
l’Outil
de
Diagnostic
Interne
Comptable
des
EPLE
(ODICé) actualisé prévoit un plan sur 3 ans qui doit inciter tous les EPLE à rentrer dans la logique de contrôle interne comptable par étapes.
Dans ce cadre, un kit de déploiement de la démarche de maîtrise des risques est mis à disposition.
Guide
d’auto diagnostic (2017).
Un
document
de présentation de la DAF fait lors de la formation de l’ESEN début 2014 : La maîtrise du risque comptable : le CIC.
Les
outils
d’Odicé
:
version
V2.2
de
2017.
Outil
composé
d’1
fichier
compressé
contenant
21
questionnaires
(format
tableur)
:
20
questionnaires
à
destination
des
ordonnateurs
(1
pour
l’établissement
support
et
19
pour
les
établissements
rattachés,
1
questionnaire
à
destination
des
agents
comptables
lié
avec
les
questionnaires
ordonnateur.
IV - Contrôle (
hiérarchisé)
sélectif des dépenses. Contrôle allégé en partenariat des dépenses.
Un
arrêté
du
10
octobre
2023
«remplace»
le
contrôle
hiérarchisé
de
la
dépense
par
le
contrôle
sélectif
en
modifiant
l’
arrêté
du
25
juillet
2013
(modifié)
portant
application
du
premier
alinéa
de
l'
article
42
du
décret
n°
2012-1246
du
7
novembre
2012
relatif
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique
et
encadrant
le
contrôle
sélectif de la dépense.
Publics concernés : les organismes visés à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Objet
:
modalités
d'élaboration
par
le
comptable
public
d'un
plan
de
contrôle
hiérarchisé
des
dépenses
des
organismes
précités
sur
la
base
duquel
il
opère
les
contrôles
définis
au
2°
de
l'article
19
et
à
l'article
20
du
décret
n°
2012-1246
du
7
novembre
2012,
en
adaptant
leur
intensité,
leur
périodicité
et
leur
périmètre.
Cet
arrêté
est
pris
pour
l'application
du
décret
n°
2012-1246
du
7
novembre
2012
relatif
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique
dont
le
premier
alinéa
de
l'article
42
définit le contrôle hiérarchisé des dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
À
noter
que,
bien
que
les
textes
soient
tous
parus,
il
semblerait
que
les
outils
actuellement
utilisés
en
EPLE
ne
permettent
pas
la
mise
en
oeuvre
de
ces
procédures.
Par contre il y a une instruction du 3 avril 2018 (
BOFIP-GCP-18-0012
) pour les organismes publics nationaux qui peut servir pour mieux appréhender la question.
V - Contrôle allégé en partenariat des dépenses.
Arrêté
du 11 mai 2011 modifié.
Une
fiche
de la DGFIP de 2018.
L'ordonnateur
et
le
comptable
peuvent
évaluer
conjointement
l'organisation
et
les
procédures
de
leurs
services
en
charge
du
traitement
d'une
ou
plusieurs
catégories
de
dépenses.
Leur
audit
porte
sur
la
fiabilité
des
procédures
d'engagement,
de
liquidation,
de
mandatement
et
de
paiement.
Il
évalue
l'efficacité
des
contrôles
opérés
à
chaque étape de traitement des dépenses.
La
portée
et
la
méthodologie
de
cet
audit
sont
définies
par
une
lettre
de
mission
signée
par
l'ordonnateur
et
le
comptable.
Celle-ci
définit
les
dépenses
concernées
par
référence aux rubriques et à leurs subdivisions de la liste des pièces justificatives des dépenses figurant en annexe du code général des collectivités territoriales.
VI - Comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au
Trésor
.
Arrêté
du
24
janvier
2013
portant
application
des
articles
43
à
47,
134,
138,
141,
142,
143,
195
et
197
du
décret
n°
2012-1246
du
7
novembre
2012
relatif
à
la
gestion
budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor.
Arrêté
du 15 septembre 2014 portant application de l'article 141 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Imprimés - modèles
Textes de base
Sommaire